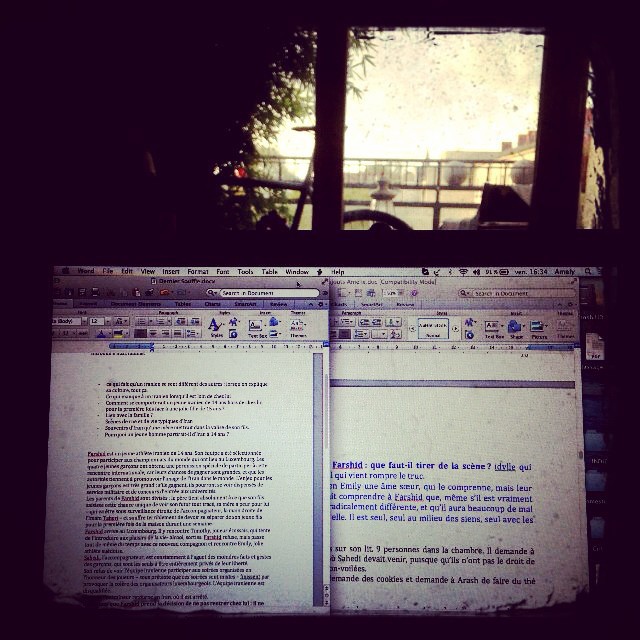Vertiges (au son du marchand de glaces oh oh oh)
Vertiges
J’ai un secret.
Tout tourne autour de moi.
J’ai un secret.
Vertige.
Mon lit, implacable, stable, s’ouvre, et je tombe, je tombe infiniment, tandis qu’au-dessus de moi virevoltent les flocons.
Les flocons.
Qui emplissent le vide et nous en font prendre conscience à la fois.
Qui tournent et tournent, tout près, trop proches, de moi.
Vertige.
Se rappeler cette tour new-yorkaise, la baie vitrée qui surplombait la ville. Le réveil du lit à en sursauter, choc ! nausée ! trentième étage, bébé !
La mort qui nous tourne autour, la mort qui vient nous effleurer, nous fondre sur le bout du nez.
Vertige.
Un secret.
Qui en rappelle un autre.
Sur un bateau, revenu d’Afrique, un jour.
La mort.
Et il la lui avait cachée.
Je sanglote, seule, dans ce lit flottant, dans ce tapis aérien, volant, zigzaguant dans la brume et les flocons de neige qui viennent s’écraser sur ma lucarne.
J’essaie de me lever, j’essaie de répondre à son rire, à ses mots, mais n’y arrive pas.
Trop tremblante encore, de fatigue, de nerfs, de froid.
Essayer de se calmer, seule, dans son coin, mais les sanglots sont chauds sur mes joues trop rouges et je ne veux rester isolée, ridicule, possédée, ce matin.
J’entrebâille la porte. Elles sont là, qui dorment. Qui dorment, mais ouvrent tout de même un œil.
Je me réfugie entre elles, et pleure toutes les larmes de mon corps, déjà prêtes à sécher.
J’ai le vertige. La prémonition.
De quoi ? Ne pas se laisser faire. Ne pas se laisser impressionner. C’est la mort, elle est joueuse, elle aime à jouer. Drama Queen comme une autre. Alors ?
« – C’est marrant, sous cet angle on dirait que la neige monte, au lieu de tomber. »
Renversée dans le lit, le crâne contre le sol, la nuque soutenue par leur doux matelas, nous observons.
Sécher ses larmes, reprendre sa respiration. Se regarder. Rire. Rire enfin.
Tout ne tourne pas, rien n’aspire, les confettis sont toujours là, je ne tombe pas, et la neige tapisse nos émois.